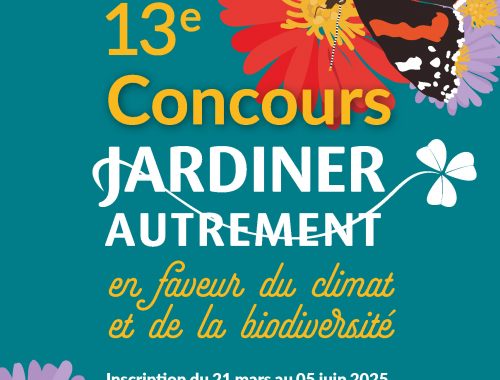Retour d’expérience sur les plantes couvre-sol sur une terre argileuse
Le rêve du jardinier : éradiquer les mauvaises herbes, favoriser la biodiversité, garder un sol souple et l’enrichir tout en diminuant les arrosages, l’entretien… les corvées !
La solution : paillage et couvre-sols, même combat ! Pas si simple…
Dans les deux cas, le sol est enrichi. Mais le couvre-sol a des avantages supplémentaires : les plantes fixent l’énergie solaire et la transforment en énergie biochimique qui est alors captée par les « chaînes alimentaires » du sol. Le couvre-sol est pérenne, ce qui nécessite moins de travail qu’un paillage à renouveler régulièrement.
Qu’est-ce qu’une plante couvre-sol ?
Définitions :
(Botanique) Plante qui pousse en s’étalant sur le sol et non en hauteur.
(Agriculture) plante cultivée en intercalaire, pour protéger les sols, sans intention de récolte.
Les engrais verts font aussi partie de ces possibilités de couvrir et d’améliorer le sol, mais ce sont surtout des intercultures et de grand développement et non des couvre-sols au sens botanique. On trouve également des arbustes couvre-sols qui ne seront pas traités dans cet article. Par contre, pourquoi ne pas faire courir au sol des plantes considérés comme des lianes (les clématites, par exemple). Nous ne parlerons ici que des couvre-sols adaptés à un sol argileux, comme dans mon jardin.
Il est nécessaire de prendre en considération les besoins et les caractéristiques des végétaux en culture pour leur associer des plantes couvre-sol dont les besoins coïncident. Comme dans les associations de plantes ou plantes compagnes, certaines plantes s’entendent mieux avec d’autres et favorisent la pousse des voisines. Le compagnonnage doit aussi tenir compte des conditions physiques requises : besoins en lumière et eau, profondeur d’enracinement, hauteur, etc.
La plante couvre-sol idéale existe-t-elle ?
Pour mon jardin, en moyenne montagne, à 600 m d’altitude en Haute-Savoie, entouré de prés, bosquets, ruisseaux et forêt, les mauvaises herbes sont « chez elles ». J’ai donc choisi de les apprivoiser, les intégrer, car la lutte serait inégale et je serai perdante ! mais surtout, je veux favoriser le plus possible la biodiversité et elles sont partie prenante dans l’écosystème.
Ainsi, beaucoup de mes couvre-sols sont indigènes et ceux que j’ai apportés se sont très bien implantés.
Pour mon jardin, comme pour tout jardin, cela dépend bien sûr de l’endroit où j’en ai besoin.
En veillant chaque fois à l’exposition, on peut distinguer parterres et massifs fleuris, potager, verger …
Les couvre-sols dans les parterres et massifs fleuris
Bergenias, stachys, alchemilles, géraniums vivaces, heuchères, hellébores, origans, s’étalent ou se ressèment bien chez moi : il est alors facile d’en enlever si elles prospèrent trop ou d’en replanter ailleurs. Des plantes indigènes sont adoptées parmi les fleurs : géranium des prés et herbe à robert, origan qu’on trouve dans la montagne tout près de chez moi, lierre terrestre, bugle rampante qui prospèrent bien alors que les variétés horticoles que j’ai voulu introduire ont vite disparues.
Je laisse également se développer le myosotis qui s’associe avec finesse aux espaces fleuris.
Il y a 3 plantes qui colonisent rapidement le terrain et ne cèdent pas la place facilement : les pervenches, le lierre et, très appréciable, le Geranium macrorrhizum.


Les couvre-sols au potager :
Mon potager ressemble plus à un jardin sauvage qu’à une succession de planches cultivées et, mâche, oseille, ciboulette, mélisse, pimprenelle, cresson de terre côtoient les adventices : cardamine, véronique, potentille, égopode, parmi les légumes que je cultive et que j’aime associer et mélanger entre eux. Les fraisiers des bois se ressèment très facilement et je les utilise entre les dalles qui servent de passe-pieds. Je réserve aussi des espaces entre ces dalles pour des thyms en allégeant alors la terre avec cailloux et terreau.
En plantant serré, en semant des espèces qui poussent rapidement au pied de celles qui occupent longtemps le terrain, on laisse peu de place aux « mauvaises herbes ».
Suivant la saison, semis de cresson alénois, mesclun, roquette, mâche, épinard, ou encore graines des sachets déjà ouverts peuvent être semées comme couvre-sol.
Futures associations auxquelles j’ai réfléchi : tétragone sous les pieds de tomates ou de courgettes, d’ailleurs avec peut-être des courgettes cultivées en hauteur.
On peut également laisser des concombres couvrir le sol au pied des tomates.
En revanche, potentille, pissenlit et bouton d’or ne sont pas admis avec les légumes, mais ont leur place dans la pelouse-prairie.
Les plantes couvre-sols au verger :
Ici, sous les grands fruitiers, le terrain est enherbé avec aussi des achillées, des bugles, les myosotis, la mélisse, l’ail des ours.
J’aime beaucoup associer les arbustes à petits fruits avec le lierre terrestre, Glechoma hederacea, dont les feuilles sont comestibles ainsi que les fleurs qui ont aussi le grand avantage d’attirer les pollinisateurs/d’être mellifères. J’ai renoncé aux fraisiers sous les cassis ou groseilliers, car ils manquaient de lumière.
Parmi ce que l’on trouve de spontané chez moi :
Véronique de Perse : elle est mellifère et se développe beaucoup dans les parties potagères. Je ne l’arrache plus, mais comme conseillé par Gertrud Franck** je la laisse en place. Si elle me gêne, je la coupe à ras du sol, laisse les racines en terre, découpe le feuillage et le laisse sur le sol là où il y a besoin d’un couvert et de compost de surface…
Egopode Aegopodium podagraria : apparue il y a quelques années seulement chez moi, elle deviendrait vite envahissante. Les racines sont très profondes, le moindre morceau se bouture, elle passe à travers le paillis… il faut une culture bien couvrante pour limiter son extension. Seul avantage : les feuilles se mangent jeunes en salade, plus grandes cuites seules ou en mélange avec orties, pissenlits, épinards, etc.
Cardamine des prés : on la trouve assez tôt en saison puis elle disparait, elle n’est jamais envahissante. Je l’attends avec impatience au printemps pour la consommer en salade.
Les pâquerettes, oxalis, primevères, trèfles, céraistes, plantain, sont plus courantes et sont à préserver car leur destruction aurait un impact majeur sur la biodiversité.

Toutes ces plantes spontanées qui avaient mauvaise presse peuvent ainsi trouver grâce auprès des jardiniers :
Elles sont bonnes pour le sol : bio-indicatrices et nourrissantes,
Elles sont bonnes pour la biodiversité,
Elles savent être bonnes pour notre santé, notre plaisir et notre moral.
Article rédigé par Marie-Françoise Savet,
Membre du groupe de travail Jardiner Autrement